Caroline Déodat
Artiste, cinéaste, chercheuse
Automne 2026

- Cinéma
- Chicago
« En confrontant archives historiques et technologies contemporaines, je souhaite développer une œuvre filmique qui rende sensibles les continuités entre passé esclavagiste, racisme structurel et construction visuelle de la justice. »
Je suis artiste, cinéaste et chercheuse. Mon parcours s’est initié par une thèse en anthropologie de l’EHESS, où j’ai travaillé sur le séga mauricien – une pratique poétique, musicale et chorégraphique née au sein de communautés marronnes pendant l’esclavage et devenue tradition touristique après la décolonisation. De cette expérience est née une interrogation persistante : développer un regard critique sur le rôle de l’anthropologue et, plus largement, sur le dispositif ethnographique, marqué par ses héritages coloniaux et ses asymétries de pouvoir.
Ce que l’archive tait, ce qui échappe à l’architecture punitive qui nous vise, constituent le terrain de mes enquêtes. Pourtant je ne cherche pas à établir un verdict ou une vérité stabilisée dans mon travail, mais de créer un espace poétique où la trace désoriente la visibilité et contourne l’aveuglement des épistémologies dominantes.
Je développe une pratique à la croisée de l’ethnographie expérimentale et de la fiction, de la recherche archivistique et de la théorie critique, en explorant les spectres des images, leur pouvoir de hantise, les processus d’aliénation, les mythes et les histoires de la violence. Dans mes films et installations, j’essaie de brouiller la transparence, de déconstruire la lisibilité immédiate, et de poser une question centrale : comment raconter la violence sans la réitérer ?
Caroline Déodat (FR/MRU/BE) est artiste, cinéaste et chercheuse. Docteure en anthropologie de l’EHESS, elle a été formée à l’École des Beaux-Arts de Lyon. Ses films ont été montrés au Museo Reina Sofía à Madrid (ES), à la Fondation Sandretto Re Rebaudengo à Turin (IT), aux rencontres photographiques de Bamako (ML), au Jeu de Paume (FR), à la Brooklyn Academy of Music (USA). Son essai Dans la polyphonie d’une île. Les fictions coloniales du séga mauricien est paru aux Éditions B42. Il a reçu le Prix Nicolás Cristóbal Guillén Batista Philosophical Literature Outstanding Book de la Caribbean Philosophical Association en 2025.
Mon projet pour la Villa Albertine s’intitule Sans innocence ou la logique du proxy. Il prend la forme d’un film en deux actes, pensé comme une enquête poétique sur les fictions de la justice et ses angles morts. Je m’intéresse à la manière dont l’innocence a été historiquement construite, instrumentalisée et mise au service de rapports de domination, de l’esclavage aux technologies contemporaines de surveillance.
Le premier acte, Sans innocence, suit un personnage qui navigue entre mémoire intime et strates historiques pour revenir notamment sur les fondements de la présomption d’innocence : l’ordonnance de 1256 promulguée par Saint Louis, les croisades et leur prolongement colonial, la fondation de Saint-Louis du Sénégal et celle de Saint-Louis du Missouri etc… Ces moments rappellent que l’innocence a longtemps été utilisée comme masque idéologique, réduisant les peuples colonisés à l’infantilisation juridique et les privant de toute parole légitime.
Le second acte, La logique du proxy, transporte ce questionnement dans le présent. Le personnage cherche à prouver son innocence dans un monde saturé d’images : caméras, bases de données, reconnaissance faciale. Mais ces preuves sont elles-mêmes filtrées par des siècles de hiérarchies raciales et de biais épistémiques. Le proxy, en tant que relais invisible, devient une métaphore futuriste centrale : peut-il ouvrir vers une justice alors que les dispositifs de preuve sont construits sur une géographie racialisée du visible, ou n’est-il qu’un instrument de contrôle qui éloigne toujours plus la parole ? Comment échapper à la mécanique du sacrifice moderne ?
Ce projet s’appuie sur mes recherches autour de la post-mémoire et des formes spectrales du témoignage. Le film cherche à inventer un langage cinématographique capable d’habiter les zones de la parole impossible du témoignage : un entre-deux où persiste le fantôme et où peut se redéfinir une justice.
La résidence se déploiera principalement à St. Louis et Chicago, deux villes où s’entrecroisent de manière aiguë les questions de justice, de mémoire et de visibilité, au cœur de mon projet.
St. Louis occupe une place centrale par son histoire raciale et juridique. Fondée sous le nom du roi Louis IX – figure associée à l’élaboration de la présomption d’innocence – la ville illustre la manière dont cette notion a pu être investie d’une charge idéologique. Elle fut aussi le théâtre de l’affaire Dred Scott, moment décisif de l’histoire de l’injustice raciale américaine. Durant la résidence, je mènerai des recherches archivistiques à la Missouri Historical Society Library, au Research Center of St. Louis, ainsi qu’auprès des archives du Gateway Arch Museum, qui conservent des documents de l’affaire et de l’histoire de la ville. Ces matériaux me permettront d’interroger comment le droit a pu disqualifier la parole noire, réduisant le corps de l’esclave à une preuve muette plutôt qu’à un témoignage recevable.
Mon travail se prolongera à Chicago, ville marquée par une histoire de surveillance et de luttes pour la justice raciale. J’y explorerai la question de la preuve visuelle en m’appuyant sur des collaborations avec des collectifs tels que l’Invisible Institute, qui enquêtent sur les violences policières à partir des méthodes OSINT.
Ces recherches s’appuient sur des apports théoriques contemporains – de Saidiya Hartman, Frank Wilderson à Judith Butler – qui montrent comment les régimes racistes de visibilité organisent à la fois l’effacement et l’hyper-exposition des vies noires. En confrontant archives historiques et technologies contemporaines, je souhaite développer une œuvre filmique qui rende sensibles les continuités entre passé esclavagiste, racisme structurel et construction visuelle de la justice.
En partenariat avec
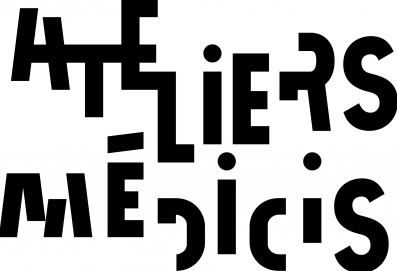
Ateliers Médicis
Situés à Clichy-sous-Bois et Montfermeil dans le département de Seine-Saint-Denis, les Ateliers Médicis s’attachent à faire émerger des voix artistiques nouvelles, diverses, et à accompagner des artistes aux langages singuliers et contemporains. Ils accueillent en résidence des artistes de toutes disciplines et soutiennent la création d’œuvres pensées en lien avec les territoires. Ils favorisent et organisent la rencontre entre artistes et habitants.

