Olivain Porry
Artiste
Mai-Juin 2026

- IA
- La Nouvelle-Orléans
« Le projet cherche à mettre en lumière les biais culturels des grands modèles de langage et envisage la créolisation comme un processus de subversion des technologies d’intelligence artificielle. »
Du ventilateur aux réseaux sociaux, les systèmes techniques ne sont pas des outils neutres, mais modèlent notre relation au monde. Dans cette perspective, ma pratique artistique se veut une exploration sociotechnique des machines qui façonnent nos quotidiens, à travers des détournements de dispositifs cybernétiques et de processus informatiques.
Mes travaux prennent la forme de systèmes d’interaction entre machines, public et environnement. Ce sont souvent des « collectifs d’objets à comportements » : des ensembles d’artefacts robotisés dont émergent des comportements collectifs. Ces formes donnent à voir, et à expérimenter, des modalités relationnelles dynamiques et mouvantes entre objets, elles déploient des situations qui questionnent les notions d’objet et de sujet, mais aussi d’auteur et de spectateur.
Aujourd’hui, alors que les intelligences artificielles génératives s’imposent dans l’espace public, le langage naturel, humain, intègre à son tour l’éventail de ces modalités relationnelles entre machines. Il devient algorithme et se voit soumis à des logiques de standardisation que je cherche à déjouer dans une démarche à la fois critique et poétique.
Par la rencontre, l’échange, l’écriture collective et la manipulation de modèles de langage, je cherche à expérimenter des subversions créatives de ces derniers : confronter l’intelligence artificielle aux processus de créolisation pour inventer collectivement des formes poétiques et politiques qui déjouent l’uniformité algorithmique et ouvrir un espace de résonance pour des voix et des récits rares dans les infrastructures techniques dominantes : celles des langues minorées et hétérogènes que sont le créole louisianais et le français cadien.
Né en 1990 à Fort-de-France, Martinique, Olivain Porry est artiste et docteur SACRe du laboratoire EnsadLab de l’école des Arts-Décoratifs de Paris (Université PSL). Formé aux Beaux-Arts de Nantes, il vit et travaille à Paris ou il est représenté par l’Avant-Galerie Vossen. Son travail explore, à travers des formes plastiques et cybernétiques, les enjeux sociotechniques des technologies contemporaines. Sa recherche doctorale, « Des communautés de machines », propose une approche de la création fondée sur la négociation entre artistes et dispositifs techniques. En 2025, il cofonde « les éditions du respirateur », une structure éditoriale expérimentale dédiée aux formes de publication conceptuelles.
« Synthetic Syncretism » est un projet qui s’attache à interroger les grands modèles de langage à l’aune des processus de créolisation. Il s’agit d’explorer, avec attention et responsabilité, ce que peut être un dialecte algorithmique né de dialogues entre IA, nourries de langues et d’histoires qui s’avèrent marginalisées dans l’espace numérique. Le projet cherche à mettre en lumière les biais culturels des grands modèles de langage et envisage la créolisation comme un processus de subversion des technologies d’intelligence artificielle.
Ancré dans un engagement de terrain en Louisiane, le projet abordera les langues vivantes telles que le créole louisianais et le français cadien non comme des matériaux à exploiter, mais comme des formes culturelles actives, riches de subjectivités, de résistances et de transmissions. Des rencontres, ateliers et échanges avec des locuteur·ices natif·ves, des chercheur·ses et des institutions locales permettront de co-construire des corpus de prompts, conçus comme des fragments d’écriture collective et performative. Loin d’être de simples instructions, ces prompts seront envisagés comme des gestes littéraires et sociaux, des formes politiques et poétiques capables d’infléchir les trajectoires des IA et de détourner leurs logiques dominantes. Le projet ne cherche ni à figer une nouvelle langue, ni à « sauvegarder » celles qui existent déjà, mais à rendre visibles les tensions, les glissements et les formes émergentes qui naissent du contact, parfois conflictuel, entre techniques computationnelles et cultures vivantes.
La résidence donnera lieu à un ensemble de dispositifs expérimentaux : éditions, installations artistiques et jeux de données formaliseront, dans la continuité de la résidence, des productions collectives et des espaces ouverts où les voix, les frictions et les imaginaires rencontrés pourront continuer à circuler.
La Louisiane constitue un territoire unique pour mener à bien Synthetic Syncretism, car elle incarne des dynamiques de créolisation linguistique et culturelle qui résonnent profondément avec les enjeux du projet. C’est l’un des rares endroits où plusieurs langues (anglais, français, créoles) ont historiquement cohabité et produit des formes d’expression hybrides, parfois conflictuelles, toujours vivantes. Ce contexte permet de confronter les imaginaires techniques des intelligences artificielles avec des formes de langage qui résistent à la standardisation.
Dans un moment où les grands modèles de langage tendent à écraser les nuances des langues minorées, travailler en Louisiane permet de rendre visible ce qui reste en marge des corpus d’entraînement. Des institutions telles que le Center for Louisiana Studies à Lafayette ou le Creole Heritage Center à Natchitoches constitue une ressource précieuse pour accéder à des archives, rencontrer des chercheur·ses engagé·es, et initier des collaborations sur les questions de langue, d’histoire et de mémoire. Des lieux comme le Cultural Center Jean Lafitte ou les médias comme Télé-Louisiane offrent aussi un ancrage contemporain essentiel pour rencontrer des locuteur·ices, collecter des récits et créer collectivement des prompts situés, nourris par des expériences vécues. Par ailleurs, la dynamique actuelle de recherche en IA en Louisiane, avec la création récente du Louisiana Institute for Artificial Intelligence et les travaux menés à Tulane ou à la University of New Orleans, permet d’envisager des échanges fertiles entre arts, sciences et technologies. C’est dans cette tension entre cultures vivantes et systèmes computationnels que le projet prend tout son sens.
En partenariat avec
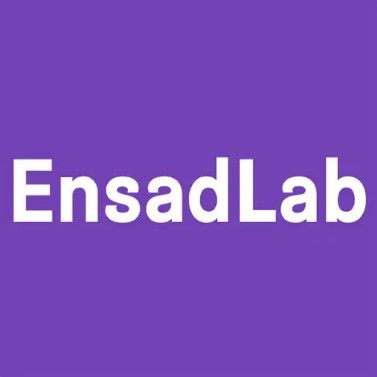
EnsadLab
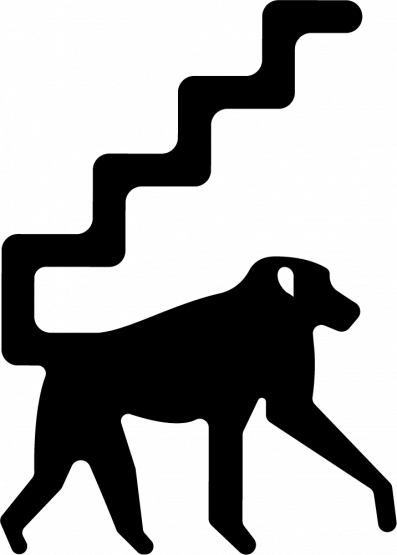
Un Singe en Hiver
Tiers-lieu culturel dijonnais ouvert en 2020, Un Singe en Hiver accueille en son sein une brasserie artisanale au rez-de-chaussée et un plateau de 150m² dédié à la création numérique et aux musiques actuelles à l’étage.

l’Avant-Galerie Vossen

Fidji Simo
CEO, Applications chez OpenAI
Fidji Simo est CEO, Applications chez OpenAI, où elle dirige les applications de l’entreprise, dont ChatGPT, ainsi que l’ensemble de ses opérations – y compris le développement produit, l’ingénierie, les ventes, la finance, le marketing, le juridique et les ressources humaines. Leader expérimentée dans la tech grand public, elle cumule plus de 15 ans d’expérience à piloter la stratégie, les produits et les opérations de certaines des entreprises les plus influentes au monde.
Avant de rejoindre OpenAI, Fidji Simo était CEO et Présidente du conseil d’administration d’Instacart, qu’elle a accompagnée jusqu’à son introduction réussie en bourse. Avant Instacart, elle a passé dix ans chez Meta, où elle a contribué à construire l’activité publicitaire de Facebook et dirigé l’application Facebook.
Fidji Simo demeure Présidente du conseil d’administration d’Instacart et siège également au conseil d’administration de Shopify. Elle est par ailleurs co-fondatrice de Chronicle Bio, une entreprise tech-bio dont la mission est de guérir des pathologies chroniques complexes.
Originaire du sud de la France, Fidji Simo est diplômée du Master in Management d’HEC Paris et a effectué sa dernière année à UCLA Anderson School of Business. Elle vit aujourd’hui en Californie avec son mari et sa fille.

