Delphine Lewandowski
Architecte et chercheuse
Juin-Juillet 2026

- Architecture
- Boston
- New York
« Ce projet s’inscrit dans un programme de recherche plus large : comprendre comment nos perceptions du monde et de la nature – que je désigne par le terme de cosmologies – influencent la conception de l’environnement bâti. »
Je suis architecte, artiste et chercheuse. J’ai grandi en étant largement coupée d’un contact direct avec les milieux naturels, et j’ai très tôt compris qu’un tel lien constituait à la fois un privilège et un socle essentiel du soin. Mon éducation au sein d’une famille sino-mauricienne m’a également donné une perspective différente sur le climat, le vivant et les relations entre humains et nature, une perspective qui continue de nourrir mon travail.
J’ai choisi l’architecture parce qu’elle offrait une manière de relier l’art et la science, la théorie et la pratique. Dès le début de mes études, j’ai été attirée par des dimensions de la nature souvent négligées en architecture, en particulier les vies non humaines qui habitent nos environnements construits, comme les insectes vivants, auxquels j’ai consacré mon mémoire de recherche. Cela m’a conduite à développer une pratique pluridisciplinaire ancrée dans la philosophie de la nature, l’éthique environnementale, les matériaux et les sciences écologiques.
J’ai obtenu ma licence professionnelle en 2019, confirmant mon engagement dans la pratique, et soutenu mon doctorat en 2023 à l’École nationale supérieure d’architecture de Paris-Malaquais – PSL, en partenariat avec le Muséum national d’Histoire naturelle. J’y ai conçu et prototypé des murs biodiversitaires, des systèmes architecturaux vivants destinés à accueillir une flore spontanée et des insectes, en collaboration avec l’agence ChartierDalix.
Mon ambition est de repenser le rôle de l’architecture à une époque marquée par les crises climatique, écologique et sociale. Je plaide pour des conceptions qui soutiennent la vie multispécifique et intègrent des cosmologies alternatives, d’autres manières de voir et de valoriser la nature. Je poursuivrai cette exploration à la Villa Albertine, en me concentrant sur les bâtiments enterrés américains, qui constituent des études de cas particulièrement riches.
Delphine Lewandowski est une architecte franco-mauricienne et professeure assistante en architecture à l’Université Penn State. Également chercheuse et artiste, elle explore dans son travail les intersections entre architecture, écologie et éthique environnementale. Au cours de son doctorat, elle a développé les « murs biodiversitaires », des parois capables d’accueillir une flore spontanée et des insectes avec une intervention humaine minimale. Ses projets ont reçu plusieurs distinctions, dont le prix international « PhD Dissertation on Cities Award » décerné par le PUCA (ministère français de la Transition écologique). Elle mène actuellement des recherches sur les cosmologies alternatives en architecture et sur la manière dont différentes conceptions de la nature influencent l’environnement bâti.
Mon projet pour la Villa Albertine, « La vie des architectures enterrées : cosmologies alternatives en architecture », explore l’héritage et l’importance contemporaine du mouvement de l’architecture souterraine, apparu aux États-Unis entre les années 1960 et 1980, dans le contexte de la crise pétrolière de 1973. Porté par des architectes tels que Malcolm Wells, ce mouvement proposait des alternatives radicales à l’architecture moderne à travers des constructions enterrées et des principes écologiques pionniers.
Cette proposition s’inscrit dans un programme de recherche plus large : comprendre comment nos perceptions du monde et de la nature – que je désigne par le terme de cosmologies – influencent la conception du cadre bâti. Pour répondre aux crises écologiques et sociales actuelles, je soutiens que la pratique architecturale doit remettre en cause de manière fondamentale la vision anthropocentrée de la nature. Cette approche rejoint les conclusions du dernier rapport de la Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES), qui appelle les décideurs à intégrer la diversité des valeurs de la nature afin de lutter contre l’érosion de la biodiversité et le changement climatique. Dans ce contexte, j’étudie plusieurs cas à travers le monde qui proposent des visions et des approches alternatives de l’architecture.
Les architectures enterrées, recouvertes de terre sur leur toiture ou partiellement enfouies dans le sol, privilégient l’harmonie avec les écosystèmes grâce à la végétalisation des toitures, à la réduction de l’impact environnemental par l’usage de matériaux biosourcés et à des stratégies bioclimatiques fondées sur l’orientation au vent et à l’ensoleillement. Bien que largement méconnues et peu étudiées en France, leurs principes résonnent fortement avec l’architecture écologique contemporaine et les efforts visant à intégrer la nature dans la conception, à l’image des murs végétalisés que j’ai conçus et étudiés au cours de ma thèse de doctorat.
Les États-Unis sont le berceau du mouvement de l’architecture souterraine, et leur histoire offre une occasion unique d’étudier comment l’intersection entre architecture, écologie et éthique environnementale s’est développée à la fin du XXe siècle. Ce mouvement a émergé d’un contexte culturel et écologique spécifique aux États-Unis, marqué par une prise de conscience environnementale croissante à la suite de la crise pétrolière de 1973. L’étudier dans son contexte d’origine est essentiel pour en comprendre pleinement les valeurs, les techniques et la portée potentielle pour l’architecture contemporaine.
Ma résidence exploratoire sera basée à New York et à Boston, les deux implantations de la Villa Albertine les plus proches des bâtiments emblématiques de l’architecture enterrée. Ces villes donnent accès à d’importants fonds d’archives architecturales ainsi qu’à des acteurs clés, tout en constituant des bases pour l’exploration des sites eux-mêmes. Les territoires que j’ai identifiés – le Massachusetts et le New Jersey – sont centraux pour cette recherche. Le Massachusetts abrite notamment la Underground Art Gallery de Malcolm Wells et la Ecology House (partiellement inachevée) de John Barnard Jr., tandis que le New Jersey accueille le bureau de Wells à Cherry Hill. À travers des visites de sites et des relevés, j’examinerai la manière dont ces bâtiments interagissent avec leurs écosystèmes, j’en documenterai l’état actuel et j’étudierai les principes architecturaux qu’ils incarnent.
Le contexte américain offre également une dimension culturelle plus large. Mes recherches s’appuient sur l’hypothèse selon laquelle le mouvement de l’architecture souterraine aurait pu s’inspirer des traditions constructives vernaculaires et autochtones d’Amérique du Nord, qui mettent en avant des cosmologies alternatives et des relations spécifiques à la nature. Explorer ces liens in situ me permettra d’examiner comment ils ont pu influencer ce mouvement. Cette perspective est particulièrement pertinente au regard des débats contemporains sur la décolonisation de l’architecture et l’intégration des savoirs autochtones dans les pratiques de conception.
En partenariat avec
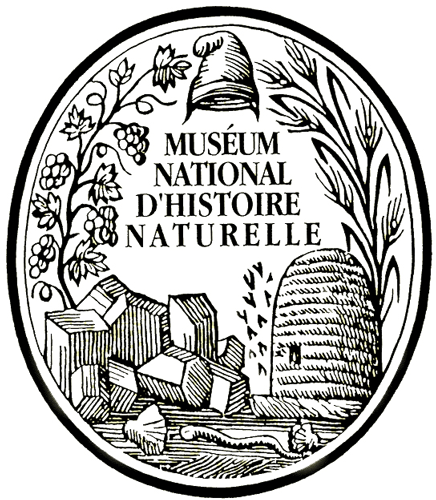
Musée National d’Histoire Naturelle
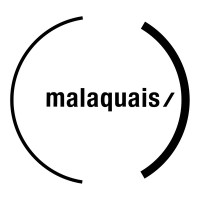
École nationale supérieure d’architecture Paris-Malaquais
L’École nationale supérieure d’architecture Paris-Malaquais a été créée en janvier 2001. Implantée au cœur de Paris, sur le site historique des études d’architecture qu’elle partage avec l’École des Beaux-Arts, l’ENSA Paris-Malaquais est à la fois une jeune école et l’héritière d’une longue tradition. Elle fait partie du réseau des 20 écoles d’architecture placées sous la tutelle du ministère de la Culture et du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.

