Adama Diop
Acteur, scénariste, réalisateur et cinéaste
Juin-Juillet 2026

- Arts de la scène
- New York
« Le théâtre comme lieu du langage et de l’abolition des frontières. »
En tant qu’artiste sénégalais vivant entre le Sénégal et la France, je m’intéresse aux formes hybrides au théâtre. Ma carrière a débuté au Sénégal en tant qu’acteur, puis s’est poursuivie en France. La confrontation avec l’altérité, dans toute sa complexité et sa violence, a rendu l’écriture et la mise en scène nécessaires pour interroger le monde.
Pour moi, la mise en scène consiste avant tout à inventer un langage théâtral qui mêle matière textuelle et cinématographique, musique, rythme et silence. Elle implique également la recherche d’une esthétique forte, ainsi qu’un travail sur la question du rituel, qui me permet de bâtir un pont avec le Sénégal et l’Afrique, mais aussi avec le monde invisible. Le théâtre, pour moi, consiste à convoquer les absents, à invoquer les fantômes. C’est le lieu par excellence du rituel.
Ma recherche artistique repose donc sur l’exploration de formes qui abolissent l’idée de frontière. C’est une réponse à un monde qui nous force à n’être qu’une seule chose à la fois, cherchant à faire de nous et de nos œuvres des archétypes ou des clichés ambulants.
L’idée est d’aborder nos sciences humaines à travers l’art, dans toute sa complexité. Nous utilisons en effet une grande diversité de matières artistiques. Même si la poésie reste mon point d’ancrage principal, j’aime travailler avec des matériaux variés, car c’est en explorant la pluralité des formes que je trouve l’unité.
Ma recherche s’articulera donc autour de plusieurs domaines : la littérature, la musique et le cinéma.
Lauréat en 2022 du Prix du Syndicat de la Critique pour le meilleur comédien dans un spectacle pour son interprétation de Lopakhine dans La Cerisaie, Adama Diop est né au Sénégal en 1981. Il a joué aussi bien dans le répertoire classique que dans des écritures contemporaines, sous la direction de grands metteurs en scène tels que Frank Castorf, Julien Gosselin ou Tiago Rodrigues. Il a également partagé la scène ou l’écran avec de grandes actrices comme Isabelle Huppert, Jeanne Balibar, Isabelle Carré ou Julia Stiles.
En tant qu’auteur, Adama Diop est lauréat 2021 du dispositif Des mots à la scène avecFajar ou l’odyssée de l’homme qui rêvait d’être poète, sa première pièce qu’il a mise en scène en 2024 et qui est toujours en tournée. Sa nouvelle pièce, L’Apocalypse d’Adam et Aimée, sera en tournée en 2026. Ses textes sont publiés aux éditions Actes Sud, et il est artiste associé à la MC2 Grenoble, au CDN de Caen et au Théâtre 71 de Malakoff. Il est également fondateur et directeur de l’EIAD (École Internationale des Acteurs et Actrices de Dakar) au Sénégal.
Il y a quelques années, je suis tombé sur un texte de James Baldwin, The Day I Was Lost. Dans la préface, j’ai appris que peu après la mort de Malcolm X en 1965, Columbia Pictures avait acheté les droits d’adaptation cinématographique de son autobiographie, coécrite avec Alex Haley, et avait demandé à Baldwin d’en écrire le scénario.
Plusieurs raisons ont empêché cette collaboration de voir le jour, mais le principal désaccord portait sur le choix de l’acteur pour incarner Malcolm X. Columbia souhaitait qu’un acteur blanc joue le rôle, grimé en noir — une pratique raciste tristement célèbre. Pendant un temps, le nom de Charlton Heston fut même évoqué. Baldwin refusa donc de faire le film, mais publia tout de même son scénario en 1971.
Quelques années plus tard, le film de Spike Lee sortit, et, avec l’Autobiographie, devint l’une des rares sources de connaissance sur Malcolm X en Europe.
À ce stade de ma lecture, j’étais déjà frappé non seulement par l’histoire de Malcolm X, mais aussi par le système qui s’est rapidement mis en place pour mettre en scène et contrôler le récit autour de lui. Cela m’a rappelé d’autres cas similaires, comme celui d’Othello, qui, pendant des siècles, fut interprété par des acteurs blancs grimés en noir, l’une des interprétations les plus célèbres étant celle de Laurence Olivier en 1965.
Timis (Crépuscule), le titre du spectacle, est la continuation d’une recherche que j’ai commencée il y a dix ans sur l’héritage de la violence. C’est la dernière partie d’une trilogie entamée avec Fajar (Aube), que j’ai créée en 2024, et Guddi (Nuit), un long métrage tourné au Sénégal en décembre 2025.
Cette recherche s’articule autour de plusieurs questions :
De quoi sommes-nous les auteurs ?
De quoi sommes-nous les héritiers ?
Comment nous débarrasser de notre passé, de nos histoires ?
Comment romantiser nos révoltes silencieuses ?
Et qui mieux que Malcolm X pour poser ces questions ?
La structure textuelle occupe une place essentielle dans mon travail. Elle s’articule selon différentes esthétiques : théâtrale, scénaristique et poétique.
J’aime également être au plus près de mon sujet, c’est pourquoi j’ai postulé à Villa Albertine. L’idée de cette résidence, pour moi, est de m’immerger pendant plusieurs semaines afin de me concentrer sur la recherche de matériaux et la rencontre de personnes. Il s’agira aussi de tenter de trouver le noyau dramaturgique du spectacle.
J’aimerais travailler avec un vidéaste pour tourner certaines images au cours de mon séjour. Il est encore trop tôt pour dire si elles feront partie du spectacle, mais je pense qu’elles seront essentielles à mon processus d’écriture. Peut-être devrai-je revenir avec une équipe pour tourner les parties cinématographiques du spectacle une fois l’écriture achevée.
J’aimerais rencontrer des spécialistes de Malcolm X, des membres de sa famille, des personnes qui l’ont connu, ou encore des Afro-Américains susceptibles de m’éclairer sur cette époque. Je souhaiterais rencontrer à la fois des universitaires et des historiens, mais aussi des artistes et des musiciens, car une part importante du spectacle reposera sur le travail autour de la musique noire américaine des années 1950, 1960, 1970 jusqu’à aujourd’hui : blues, jazz, soul et hip-hop.
Ces rencontres pourraient d’ailleurs conduire à inviter certains de ces artistes à participer au spectacle.
En partenariat avec

La Comédie de Caen
https://www.comediedecaen.com/

MC2 Grenoble
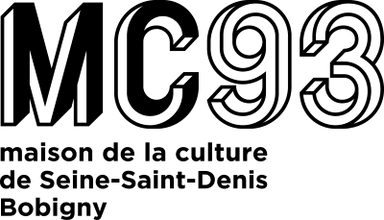
Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis Bobigny (MC93)
Par sa programmation artistique, sa réputation et son évolution, la MC93, héritière des ambitieuses maisons de la culture voulues par l’Etat et portée par les collectivités locales, occupe une place singulière dans le label des Scènes Nationales puisqu’elle est à la fois un lieu de production de spectacle et ouverte sur l’international depuis son origine. Inscrite dans un territoire populaire en pleine mutation, la MC93 s’est aussi dotée d’une « Fabrique d’expériences » qui regroupe des ateliers de pratique, des résidences de création impliquant des habitants du territoire, des endroits de rencontres et de réflexions qui concourent à renouveler le rapport de l’institution qu’elle est, avec ses usagers. Depuis 2015, elle est dirigée par Hortense Archambault pour y mener un projet qui vise à faire du théâtre le lieu des possibles, un lieu public qui réinterroge sans cesse la question des communs en tenant compte des évolutions de notre société. Du commun en effet s’y fabrique dans notre capacité à partager avec les autres une expérience esthétique, d’éprouver nos divergences et de les affronter. Depuis 2020, elle est Pôle Européen de Production.

Théâtre 71 Malakoff, Scène nationale
https://www.malakoff.fr/280/bouger/vie-culturelle-a-malakoff/theatre-71-scene-nationale.htm


