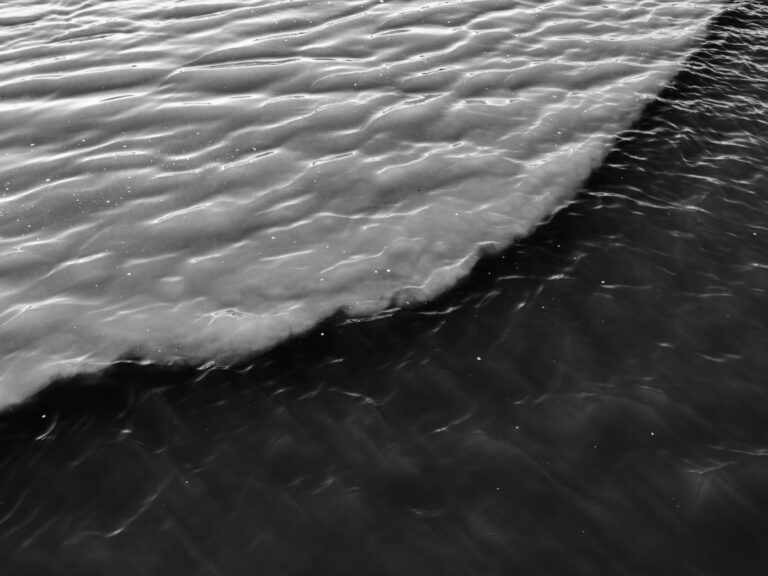
Art History in the Creation of Racial Identity

Kehinde Wiley, Napoleon Leading the Army over the Alps (2005), Brooklyn Museum
Par Raphaël Bourgois
Aussi étrange que cela puisse paraître, l’histoire de l’art a tardé à s’intéresser à la construction des identités raciales. Pourtant, les questions de ce qui est vu, de ce qui est montré, de l’invention de la « noirceur » et de la « blancheur » sont centrales, comme l’a brillamment exposé Anne Lafont. L’historienne navigue entre les périodes du XVIIIe et du XIXe siècle, et a montré comment un regard se construit alors sur les corps noirs, de manière cohérente avec la formation d’un canon artistique. Canon qui est aujourd’hui réapproprié et questionné par les artistes noirs.
Existe-t-il un regard propre à l’histoire de l’art sur la question de la race ?
Pour être parfaitement honnête, cette question de la race n’a pas tout de suite été centrale dans mes travaux. C’est après ma thèse, une fois en poste, que j’ai cherché à explorer des chemins nouveaux, et que je me suis intéressée à la question de la représentation des Noirs. C’était alors un objet qu’il fallait construire et j’avoue que je n’ai compris l’importance de ce travail fondamental que plusieurs années après le début de mes recherches iconographiques sur la construction de la race et du racisme. Il y a donc eu deux temps, d’abord une recherche positive par la documentation d’un corpus inédit sur l’image des noirs dans l’histoire de l’art, puis une étude historique de la race fondée sur des objets visuels et artistiques qui me permettait d’aller plus loin. C’était aussi, il y a 15 ans, la possibilité de participer à un chantier collectif et pluridisciplinaire, mobilisant les histoires politique, sociale, intellectuelle, et l’histoire de l’art, sous l’impulsion de Jean-Frédéric Schaub et Silvia Sebastiani à l’École des Hautes études en Sciences Sociales (EHESS). Il était paradoxalement très compliqué alors d’aborder ces questions dans ma discipline, l’histoire de l’art, qui traite pourtant directement de la visualité, qui est de manière évidente au cœur de l’expérience même de la race. Est-il besoin de rappeler que c’est d’abord par la vue que se définit le familier et l’étranger, le similaire et le différent ? Il a malgré tout fallu batailler pour montrer que l’archive visuelle était particulièrement intéressante lorsqu’on s’intéressait à l’histoire de la race.
Vous travaillez sur le XVIIIe siècle, siècle des Lumières mais aussi de l’apogée de la traite des esclaves. Comment résoudre cette apparente contradiction qu’on retrouve aujourd’hui dans les débats sur la question du racisme et de l’universalisme ?
Je ne la résous pas ! Comme historienne, je constate la réalité de cette contradiction entre la pensée universaliste et la réalité de l’esclavage et de la traite dès le XVIIIe siècle, et ce qui me semble important c’est avant tout de pouvoir en faire état, puis de suivre l’émergence et le déploiement de cette apparente contradiction. Selon moi, l’esclavage aiguise la définition de la citoyenneté, et par conséquent de l’universalisme républicain, en ce que ce statut social et politique de citoyen était pensé volontairement in abstracto. L’esclavage est donc l’épreuve fondamentale d’une citoyenneté renouvelée par les révolutions politiques à l’échelle atlantique.
Le paradoxe de l’ambition universaliste et de l’esclavage racial n’a pas toujours été inconcevable. L’histoire qui se dessine en réalité, quand on s’y intéresse vraiment, est moins pure que ce qu’affirment tant les adversaires que les partisans de l’universalisme, et c’est bien là toute la complexité des Lumières. De mon point de vue, l’expérience de l’esclavage de masse, la traite de 12 millions d’Africains, les plantations coloniales, l’organisation rationnelle et cruelle de la déshumanisation et de l’exploitation de l’homme par l’homme, nous obligent à regarder ce que fut concrètement la citoyenneté au cours du XIXe siècle. En revanche, que l’esclavage racial et la pensée universaliste aient cohabité, cela ne me surprend pas. Au contraire, je pense même que, d’une certaine manière, l’irrationalité du premier excite la dépense intellectuelle de la seconde.
Vous évoquez dans votre dernier ouvrage ce que vous appelez une « politique de la blancheur », qui est aussi une esthétique, qui se développe au XVIIIe siècle. En quoi l’approche par l’histoire de l’art permet-elle de renouveler le regard sur cette question ?
Lorsque j’ai présenté le résultat de mes recherches, qui ont débouché en 2019 sur L’Art et la Race : l’Africain (tout) contre l’œil des Lumières, un historien dont je tairai le nom, avait cru bon de me dire que ce travail ne reposait sur rien. Ce qui voulait dire dans sa bouche qu’il n’y avait même pas la matière, le corpus d’archives et d’œuvres, pour pouvoir effectuer un travail sérieux et important d’historienne sur ce sujet ; que, depuis la discipline histoire de l’art, la question de la construction de la race au siècle des Lumières était finalement nulle et non avenue. Je dois avouer que cela m’a d’abord beaucoup vexée, puis cela m’a mise en colère car c’était objectivement de la mauvaise foi. Il y a en réalité – comme on le voit dans mon livre – une grande diversité de représentations, de nombreuses itérations de la figure des Noirs à différents niveaux de la vie sociale, tels qu’ils ont été immortalisés par les archives visuelles. J’ai donc travaillé aussi sur la quantité, au poids, afin de montrer qu’il ne s’agissait pas de pièces exceptionnelles, bien au contraire.
Pour ce qui concerne la fabrique de la blancheur comme identité raciale, c’est le fruit de la confrontation avec la noirceur incarnée par la présence accrue des Africains dans l’Europe des XVIIIe et XIXe siècles. L’expérience rapprochée et amplifiée de l’altérité noire a, en retour, rendue nécessaires l’affirmation et la performance de la blancheur, ce qui a induit des pratiques sociales comme l’utilisation de poudres pour les cheveux et le visage. Ce que j’appelle « l’œil des Lumières » est, de mon point de vue, obsédé par les sujets noirs, les corps noirs, l’africanité. Aussi, pour répondre indirectement et des années après à ce collègue, il n’y a pas « rien », bien au contraire, il existe une quantité d’objets qui permettent de poser la question de la race dans tous les lieux et à partir de toutes les pièces dont l’histoire de l’art s’est toujours occupée. Ce n’est pas extérieure à la discipline, je dirais même que c’est au cœur du corpus, quasiment de tout le corpus artistique du XVIIIe siècle.
C’et une question qui est au cœur aujourd’hui des recherches académiques, et notamment des critcal race theories : quelles archives mobiliser quand il y a soit une totale absence de la voix des Noirs, soit elle est relayée dans des archives qui sont celles des dominants ?
C’est toute la question. On peut d’abord, et c’est la réponse la plus facile, s’intéresser à la mémoire comme phénomène et en faire un objet historique. Comment cette mémoire s’est transmise et est parvenue à survivre à l’absence de matérialisation originale par les acteurs. Mais on peut aussi – et c’est actuellement une tendance importante de la recherche aux États-Unis, à propos de laquelle, en tant qu’historienne, je m’interroge encore beaucoup –, compenser l’absence d’archives, par la mise en œuvre d’un projet fictionnel. C’est une démarche avec laquelle je ne suis pas tout à fait à l’aise, car je pense qu’en réalité il n’y a jamais tout à fait « rien », et que l’on peut, avec toute la rigueur historique possible, faire feu de tout bois, c’est-à-dire travailler l’archive coloniale et entendre les voix noires qui se trouvent dedans, même de manière indirecte. Sans avoir un avis arrêté sur la question de la fiction, qui a définitivement ses vertus, je suis, dans mon travail, encore prudente, et continue d’explorer l’archive coloniale qui ne me semble pas avoir encore tout dit.

Portrait of a Creole Woman in a Madras Tignon, attributed to George Catlin, oil on canvas, Virginia Museum of Fine Arts
Si vous avez travaillé au poids, pour reprendre vos mots, dans votre dernier ouvrage, votre résidence à la Nouvelle Orléans vous a permis de vous pencher précisément sur une personnalité : Marie Laveau. Qui est-elle et pourquoi était-il important pour vous de mener des recherches sur elle ?
Marie Laveau était une prêtresse vaudou de La Nouvelle-Orléans, qui avait épousé en 1819 un affranchi émigré d’Haïti nommé Gabriel Paris, et qui tenait une consultation de divination très courue. À mes yeux, elle s’inscrit aussi dans un ensemble de femmes fortes, noires, de l’espace atlantique, qui se distinguaient par leur esprit d’initiative, leur liberté, leur succès dans les affaires… malgré les contraintes coloniales et impériales tout autour de l’Océan. Marie Laveau est donc une icône à qui on prête des pouvoirs surnaturels mais aussi une grande sagesse, associée aussi bien à l’imaginaire artistique de la Louisiane qu’au mouvement pour les droits civiques. Par ailleurs, il n’existe aucun portrait original de Marie Laveau, la seule image, c’est une copie d’un tableau de la fin du XIXe siècle, d’après un tableau du peintre américain George Caitlin. Comme je l’ai fait dans mon livre à propos de Toussaint-Louverture, j’aime me confronter autant au portrait qu’à l’absence de portrait, car cette histoire, avec ses fluctuations – Marie Laveau fait désormais l’objet d’une imagerie populaire abondante – révèle les rôles de l’image dans le travail mémoriel. C’est d’autant plus intéressant que les formes d’appropriation de l’histoire noire par divers groupes sociaux vont de pair avec l’émergence de types de savoirs variés, et souvent nouveaux. C’est le cas de l’histoire noire, pour laquelle les sources, comme nous l’avons déjà dit, sont moins conventionnelles, parce que les archives écrites n’ont pour la plupart pas été produites par les acteurs, en l’occurrence les esclaves, à qui on interdisait d’apprendre à lire et à écrire. Aussi, entendre les voix noires dans les archives coloniales et impériales, oblige à travailler de biais. Mais on les entend…
On trouve chez des artistes contemporains, africains-américains notamment, une certaine façon de produire un récit alternatif, de donner sa place à un regard noir sur l’histoire, en se réappropriant les motifs de l’art occidental classique. On peut penser aux photographies d’Ayana Jackson ou aux portraits de Kehinde Wiley. Quel regard portez-vous sur ce mouvement ?
Je vois d’abord une tendance longue, assez généralisée, qui a pris des formes très diverses et dont on peut faire remonter les origines au Black British Art des années 1980. Je pense par exemple au dialogue étroit qu’a entretenu Yinka Shonibare avec William Hogarth. J’avais découvert les œuvres de Shonibare dans l’exposition Hogarth du musée du Louvre en 2006 : il s’agissait d’une série de 5 photographies (Diary of a Victorian Dandy, 1998) d’après la série de 8 gravures de Hogarth : The Rake’s Progress (1735). Dans ce cycle, l’artiste contemporain était lui-même le personnage principal d’une épopée photographique calquée sur le récit en gravures de son prédécesseur, créant ainsi un décalage saisissant dans une imagerie familière.
Dans l’art africain-américain, il y a bien sûr les exemples les plus connus comme l’œuvre de Kehinde Wiley, qui a produit des tableaux remarquables. Par exemple, j’ai revu récemment au musée de Brooklyn son tableau inspiré du Bonaparte franchissant les Alpes de David, avec une figure noire à la place de l’empereur. Il s’est joué, dans ce type d’approches – qui fait un peu trop recette à mon goût désormais –, quelque chose de fondamental : une façon de se mesurer aux canons d’un art dont on se pensait exclu. Décaler le canon, en le rendant plus noir, fonctionne très bien car cela permet d’introduire l’étranger dans le connu, le moins familier dans le commun. Et ce qui ressort de ces démarches artistiques, c’est surtout que l’altérité n’est pas si grande que cela. Ce qui pourrait suggérer que dans le monde de l’art et de la culture, l’opération de rattrapage de visibilité est achevée.

Kerry James Marshall, School of Beauty, School of Culture (2012), Birmingham Museum of Art
Si cela est acquis, que reste-t-il ? Qu’est-ce qui vous paraît intéressant comme démarche ?
Peut-être peut-on désormais aller au-delà de ce rattrapage, étape qui a été nécessaire mais qui a occulté d’autres approches artistiques plus fines de l’expérience africaine-américaine. Je pense par exemple au travail de cette grande artiste qui a œuvré tout au long du XXe siècle, et même au-delà : Elizabeth Catlett (1913-2012), et dont l’œuvre a pris plusieurs formes (sculpture, gravure, peinture). Très engagée politiquement, elle a participé à la lutte pour les droits civiques par une œuvre qui affirmait la nécessité pour les Noirs américains de trouver leurs propres moyens artistiques. Elle recourait à l’image suivante pour illustrer son propos : « nous avons fini par arrêter de penser que nous devions avoir les cheveux raides », et cette idée puissante devait selon elle s’appliquer aux formes représentant et s’adressant aux Noirs. L’image est très parlante, dans l’absolu, mais d’autant plus quand on pense à l’une de ses sculptures conservées au Metropolitan Museum of Art : Woman fixing her hair (1993)[1].
C’est aussi la démarche adoptée par Kerry James Marshall par exemple, qui, dans son magnifique tableau intitulé School of beauty, School of culture (2012, Birmingham Museum of Art), fait, parmi d’autres, référence aux Ambassadeurs d’Holbein (1533, Londres, National Gallery) en utilisant le même subterfuge optique que le peintre allemand. On voit en effet dans le bas du tableau l’anamorphose d’une jeune fille blonde : la belle au bois dormant de Disney, au sein d’un salon de coiffure africain-américain. On retrouve le thème important de la coiffure, qui renvoie à la question de la norme et de la beauté noires. Mais l’emploi de l’anamorphose devient ici une façon de représenter l’informe et l’inopportun. L’artiste donne un espace à la beauté comme à la culture noire, qui ne sont pas nécessairement la négation de l’esthétique « blonde », mais qui s’en détachent, en rejetant cette norme dans une forme incongrue, peut-être jadis obsessionnelle, mais désormais ignorée et inappropriée, et finalement inefficace comme modèle dans cette école de beauté et de culture africaine-américaine. Kerry James Marshall joue avec les canons de l’art de la renaissance allemande, en plus et en marge de ceux propre à la culture panafricaine.
Ce qu’il y a d’intéressant, selon moi, c’est qu’il s’agit d’une démarche subtile, qui dit le crédit, la connaissance, la culture sur laquelle se fonde toute intervention dans le domaine artistique. Ainsi, l’œuvre de Marshall pense plastiquement avec des moyens et un imaginaire qui vont au-delà de la citation d’un canon européen ancien, ou de la simple introduction de modèles noirs dans les schémas artistiques d’Ancien Régime. Aussi, pour ce qui concerne les démarches les plus intéressantes de l’intervention noire dans l’art actuel, je dirais qu’elles se situent dans leur capacité à dépasser le rattrapage historique au profit de l’invention de moyens propres et ajournés, qui disent au plus près l’histoire et l’expérience Africaine-Américaine. Et nombreux sont les artistes remarquables qui vont dans ce sens.
[1] « … we stopped thinking that we had to have straight hair… ». C’est dans une conversation avec Samella S. Lewis qu’Elizabeth Catlett a fait ce parallèle. Voir Samella S. Lewis, African American Art and Artists, Los Angeles, University of California Press, 2003, p. 135.
Cet article a été initialement publié dans States, la revue de la Villa Albertine.


