Rose Vidal
Artiste, écrivaine, critique d'art
Eté 2026

- Fiction
- Littérature
- Chicago
- New York
- San Francisco
« Tant qu’il y aura de la douleur, et tant que la crise des opioïdes nous renverra violemment à notre incapacité à véritablement la traiter, il y aura toujours mille formes à inventer, réinventer, partager, et travailler à l’infini. »
Je suis artiste, écrivaine et critique d’art. J’ai fait des études de lettres avant de passer le diplôme de l’Ecole des Arts Décoratifs en 2025.
Quand je découvre en 2021 l’ampleur de la crise des opioïdes, c’est un choc qui me fait apparaître la douleur comme une clef essentielle à la compréhension de nos sociétés contemporaines. À la croisée d’enjeux politiques, sociaux, économiques, médicaux, mais également culturels, ontologiques, esthétiques, anthropologiques, historiques, la douleur ne s’appréhende qu’à travers des représentations. C’est pour moi une forme d’évidence : puisque l’art est le véhicule et la fabrique des représentations et donc de nos façons de ressentir la douleur, alors la douleur engage l’art à lui répondre.
Je crois que penser l’art comme un antidouleur, transformer les gestes en laboratoire, les œuvres en remèdes ou façons de traiter les sujets permet de le réconcilier avec des fonctions sociales essentielles : le soin, le partage, la transmission, l’échange. L’art peut ainsi se rendre encore plus responsable de ses propres effets : se demander comment les mesurer auprès de son public, les ajuster, les diriger vers la société, les rendre utiles à des enjeux culturels et sociaux profonds.
Ma réflexion a notamment pris la forme d’un livre, Drama doll, publié aux Editions Gallimard en 2025 – mais tant qu’il y aura de la douleur, et tant que la crise des opioïdes nous renverra violemment à notre incapacité à véritablement la traiter, il y aura toujours mille formes à inventer, réinventer, partager, et travailler à l’infini.
Rose Vidal est artiste, autrice et critique d’art. Artiste painkiller, « mercenaire antidouleur », elle propose d’imaginer l’art comme une fabrique d’antidouleurs plastiques, pour éprouver le pari d’une fonction curative ou palliative des œuvres. Ce projet porté en résidence à la Villa Médicis en 2023 continue de se déployer après un premier roman, Drama doll publié en mars 2025 (Editions Gallimard). À partir des récits de la douleur, l’artiste fabrique des œuvres plastiques, textuelles et performées à la lisière du design : il s’agit toujours d’employer la fiction à l’extension et l’assouplissement de nos usages quotidiens du monde.
Drama doll formalisait une interrogation réflexive et narrative sur la douleur. Je veux à présent confronter ces recherches à la crise des opioïdes, examiner ses réalités, entendre les personnes qui la vivent, la combattent, en souffrent, pour dégager des méthodes d’écoute, d’écriture et de mise en forme des histoires rencontrées. Faire de mon enquête un espace de rencontres et d’échanges d’outils pour mieux comprendre ce qui se trame aux Etats-Unis : que dit cette crise de son histoire, de sa culture, de ses gens ? Quelles possibilités, quelles perspectives laisse-t-elle ?
Je ne suis jamais allée aux Etats-Unis, mais des choses s’y passent qui me sont douloureuses. Ça commence à San Francisco, où Emmanuelle dont je raconte l’histoire dans Drama doll a accouché et perdu son bébé. Vingt-cinq ans plus tard, je vais là-bas pour clore le livre d’Emmanuelle, et en ouvrir un second, aujourd’hui. Rien de mieux qu’une clinique pour s’ouvrir à de nouvelles histoires. Je m’imagine peut-être y croiser le fantôme du fils perdu ; avant de réaliser que parmi les médecins, les personnes soignées, leurs familles, il y a tant d’histoires réelles pour me hanter mieux que des fantômes. Entendrai-je les voix de ces gens « sans histoires » à la Ray Carver ? Eux n’ont jamais imaginé que leur vie pouvait bien intéresser une personne ici-bas, pas plus que là-haut d’ailleurs, ni plus qu’eux-mêmes, si bien qu’ils n’ont jamais pris la peine de raconter, ni leurs joies, ni leurs peines, pour se contenter simplement de les vivre, glissant dans le décor des États-Unis comme une feuille tombe dans l’interstice entre le mur et le bureau, et s’oublie là pour ne plus jamais être lue. Mais on ne peut plus se contenter de les oublier. Et pour cela il faut prendre la peine de les raconter.
San Francisco est un point de départ : là où Emmanuelle a vécu, et également « Fentanyl City », dans un contraste saisissant entre la poursuite par la Silicon Valley d’un idéal de contrôle technologique sur la santé et l’immortalité, et la souffrance visible d’un espace public ravagé par la crise. Je m’intéresse au quotidien de la population, aux décors qui témoignent de cette histoire et ceux qui lui échappent, ainsi qu’aux institutions et aux politiques de soin. J’espère ainsi rencontrer des personnes dont le métier est de lutter contre la crise et d’accompagner des populations touchées.
Chicago offre des perspectives riches sur les clivages sociaux et la manière dont les communautés s’organisent pour faire face aux défis. J’espère rencontrer des contacts au Département de la santé publique de Chicago, dans les universités ou au sein de tout dispositif traitant la santé en lien avec le cadre urbain et social, en résonance avec l’influente école sociologique de Chicago. Je suis déjà en contact avec Alice Centamore, doctorante à l’Université de Chicago et historienne de l’art impliquée dans le Prison + Neighborhood Arts/Education Project. Alice mène des recherches sur les « Janes », un groupe de femmes qui proposaient des conseils et pratiquaient des avortements dans les années 1970, et elle est proche d’initiatives locales qui perpétuent cet héritage.
À New York, je souhaite explorer comment les grandes crises, telles que les épidémies de crack et d’héroïne, ont façonné les communautés artistiques et inspiré de nouvelles formes d’activisme et d’engagement social. Je souhaite me rapprocher de Nan Goldin et du collectif P.A.I.N., qui mêle art et militantisme pour dénoncer l’épidémie liée aux antidouleurs.
En partenariat avec
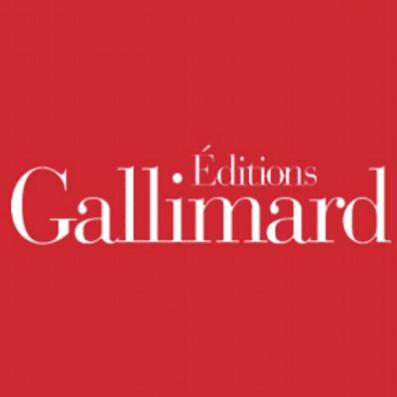
Editions Gallimard
Les Éditions Gallimard, fondées par Gaston Gallimard en 1911, sont l’un des principaux éditeurs français de livres. Son catalogue comprend 36 lauréats du prix Goncourt, 38 écrivains ayant reçu le prix Nobel de littérature et dix écrivains ayant reçu le prix Pulitzer.

