Le Pouvoir du collectif : Culture, Identité et Empowerment
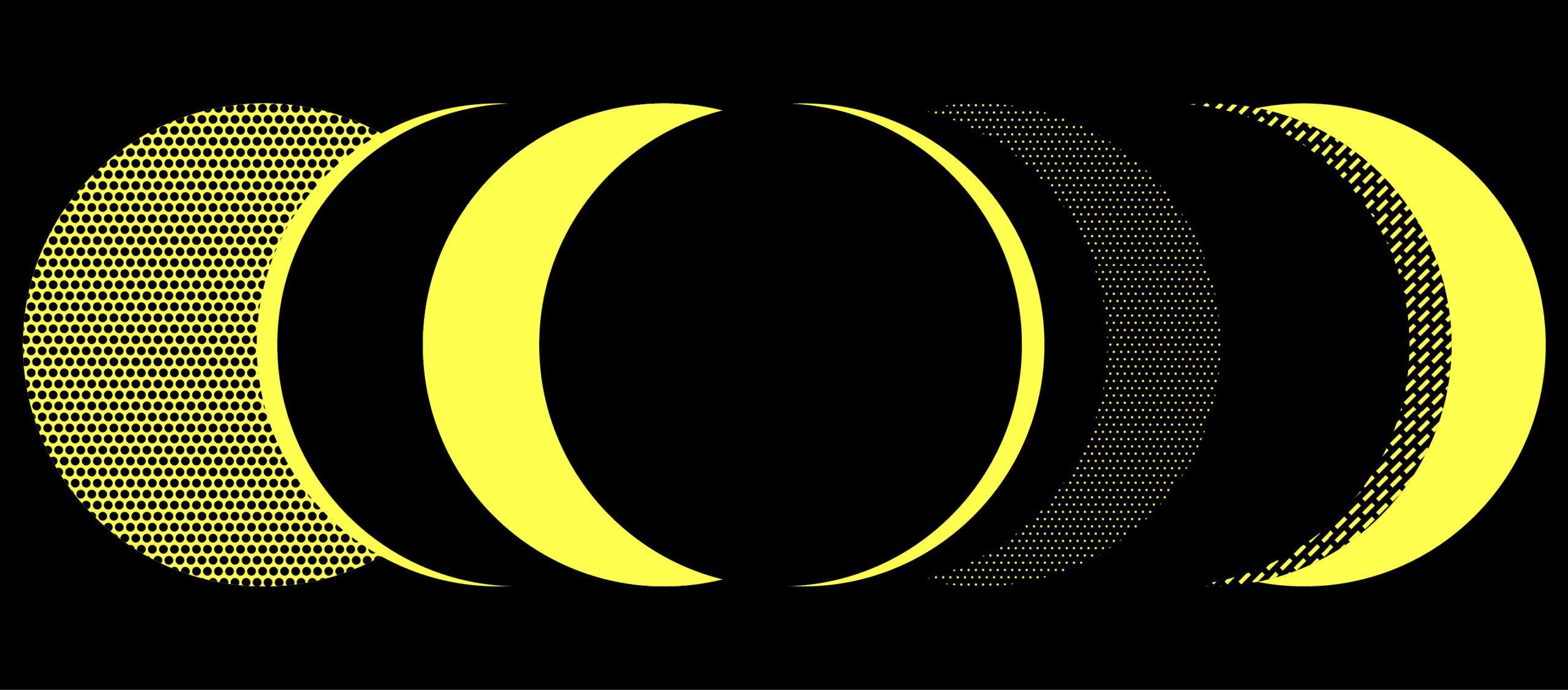
Par Raphaël Bourgois
Tiana Webb Evans et Lydia Amarouche participent toutes deux à la Nuit des idées de Jersey City, mais ne partagerons pas la scène, malgré leurs nombreux points communs. Pour y remédier, le magazine de la Villa Albertine a organisé une rencontre en amont de l’événement. Elles abordent ici les questions urbaines liées à l’inclusion, en mettant l’accent sur le rôle central de la littérature, l’engagement communautaire et les arts. Elles s’appuient pour ça sur leurs projets respectifs : Yard Concept et Shed Publishing.
Tiana, pourriez-vous nous expliquer comment fonctionne Yard Concept, qui se définit comme « une plateforme d’apprentissage centrée sur l’investigation culturelle et la conscience collective » ? Son influence a été déterminante pour aborder la question des défis urbains au centre de cette édition de La Nuit des Idées.
Tiana Webb Evans : Tout a commencé en 2018. Pour ceux d’entre nous qui ne sont pas artistes plasticiens, il y a un risque de perdre de vue son identité. Surtout aux États-Unis, où les citoyens sont considérés comme faisant partie d’une industrie ou, selon l’expression de James Baldwin, d’une chaîne de production. Ce que nous faisons pour gagner notre vie devient notre identité. J’étais arrivée à un point où mes travaux de recherche et mes centres d’intérêt personnels ne faisaient plus partie de ma vie quotidienne. Yard Concept est ma solution à ce problème et englobe les divers centres d’intérêt de mes 20 années dans le monde de l’art et du design, dans toute leur complexité.
Je m’intéresse beaucoup à la philosophie, et comme je viens des Caraïbes, j’attache une grande importance au concept d’enracinement, mais aussi de ramification. Avec Yard Concept, je m’efforce de rassembler différentes voix au travers d’un journal numérique, de conversations, de poèmes, d’essais et d’interviews. Mon but est de créer une communauté vivante et dynamique qui accueille des personnes du monde entier, de tous les âges, et qui font toutes preuve d’une grande curiosité.
En tant qu’amoureuse des livres, j’ai réfléchi au fait que ceux d’entre nous qui travaillent dans le domaine des arts et des sciences humaines partent souvent du principe que nous avons tous les mêmes références culturelles. Mais mon expérience des réseaux sociaux m’a prouvé que ce n’est pas toujours le cas et je me suis rendue compte que certains livres nécessitent un important niveau de connaissances préalable pour être pleinement appréciés.
La question est donc de savoir comment partager cela. Comment partager ces informations, ces points de vue, ces façons d’être avec les autres sans la pression d’un club de lecture, sans exiger de quelqu’un qu’il ait l’équivalent de cinq ans de lecture derrière lui avant de pouvoir se joindre à une discussion ? C’est ce qui a donné naissance aux Yard Concept Reading Circles.
Ces cercles de lecture ont commencé à la Gavin Brown’s Enterprise, une ancienne galerie d’art très populaire à Harlem. Ils s’appuient sur une discussion en commun plutôt que sur des lectures individuelles, ce qui permet des échanges inclusifs et diversifiés. Cette approche remet aussi en question la binarité qui prévaut en matière de genre, de race et d’âge, et qui est un vrai poison et une source de division dans notre société. Faire converser ensemble des inconnus devient un acte radical. Très souvent, les gens qui assistent aux cercles de lecture lisent les livres après coup, une fois l’événement terminé.
Lydia, vous avez créé votre propre maison d’édition, Shed Publishing. Pourriez-vous nous expliquer comment vous rassemblez du matériel, comment vous trouvez un terrain culturel commun à partir de livres et de connaissances ancrés dans une communauté, afin de leur donner une portée plus universelle ?
Lydia Amarouche : J’ai conçu Shed Publishing il y a environ quatre ans, pour combler un manque en France, où les espaces physiques de réunion pour le mouvement antiraciste sont rares. Des centres culturels comme Khiasma, créé par Olivier Marboeuf aux Lilas (93), et La Colonie à Paris, fondé par l’artiste franco-algérien Kader Attia, ont joué un rôle clé dans la promotion d’échanges intellectuels et artistiques ancrés dans la diversité. Malheureusement, à cause de la pandémie et du manque de financement public, les deux centres ont fermé.
Il existe tout de même encore d’excellentes initiatives, comme Filles de Blédards et Mwasi, qui font partie du collectif afroféministe, mais je voulais créer un espace de liberté distinct des institutions et du monde universitaire. J’ai aussi le sentiment que lorsqu’on a sa propre structure, on peut dialoguer plus efficacement avec les institutions.
À l’époque, comme Tiana, j’organisais des ateliers avec des groupes de lecture. J’utilisais la méthode de l’arpentage, issue de la culture des syndicats au XIXe siècle en France. C’est une forme d’exploration qui était employée par les travailleurs désireux de s’instruire et de lire des ouvrages de théorie politique, mais qui n’avaient ni le temps ni l’argent pour s’acheter des livres. Le principe de l’arpentage, c’est de prendre un livre, de le découper en plusieurs morceaux, et de les distribuer au groupe. Chacun reçoit le même nombre de pages, qu’il lit de son côté. Ensuite, le groupe se réunit et chacun partage ce qu’il a appris. Cette méthode a été adoptée par les milieux militants.
L’un des premiers livres que j’ai lus collectivement dans ces groupes était l’œuvre d’une architecte, Samia Henni, qui mettait en lumière la façon dont l’architecture avait été utilisée dans l’Algérie colonisée pour supprimer toute velléité d’indépendance ou de révolte. Le livre évoquait la manière dont les expérimentations architecturales menées dans les colonies avaient eu un impact sur les paysages urbains français, comme les grands ensembles dans les banlieues. Cela m’a fait réaliser combien il était difficile de discuter de l’impact de la colonisation sur l’architecture française, ou dans tout autre domaine, avec une approche systémique. J’ai donc décidé de créer une maison d’édition où nous pourrions travailler et expérimenter de façon collective. Je voulais aussi créer une collection pour les enfants, pour préserver et prendre soin des communautés sous-représentées, et publier de simples histoires les concernant, à lire au moment du coucher, comme il y en a tant ici aux États-Unis.
Les livres peuvent être intimidants, surtout dans ces communautés sous-représentées avec lesquelles vous travaillez. Pourquoi avez-vous toutes les deux choisi les livres et comment travaillez-vous sur cette idée d’intimidation culturelle ?
TW : C’est drôle, on en revient toujours à l’histoire moderne et au colonialisme. La majorité des personnes réduites en esclavage aux États-Unis n’avaient pas le droit de lire ; le faire était un privilège. À un moment donné, un contre-récit s’est développé, et suscité un rejet insidieux de l’intellectualisme qui a récemment gagné encore plus de terrain auprès d’une large frange de la société américaine.
En tant que New-Yorkaise d’origine jamaïcaine, j’ai fait l’expérience de cette fracture. Les personnes d’origine caribéenne ont la réputation d’être bien éduquées. Évidemment, c’est une généralisation. Dans la culture jamaïcaine en particulier, il y a une tradition d’engagement philosophique, que ce soit à travers la Bible ou par d’autres moyens officiels. À tel point qu’à Kingston, il y a des types qui ont un van-librairie et vont vendre des livres à la sortie des fêtes. Donc ce rejet de la lecture m’est inconnu. Je sais que le côté intimidant vient d’injonctions culturelles. Les livres sont des objets extrêmement puissants. Ils peuvent vraiment transformer quelqu’un. Je crois que dans le contexte des États-Unis, penser est un acte radical, tout comme le fait de remettre les choses en question, parce que nous sommes prisonniers du consumérisme et de la recherche de la richesse matérielle.
LA : Quand je pense aux livres, je les trouve effectivement intimidants. Je voulais faire bouger les choses à différents niveaux. Grâce aux livres que nous publions, je souhaitais faire découvrir d’autres points de vue et sortir de la figure classique de l’intellectuel, qui est si prégnante en France. Nous avons un discours universitaire très bien rôdé – et c’était important pour moi de travailler avec des gens qui maîtrisent ces concepts – mais ça m’intéressait aussi de travailler avec des militants associatifs, des associations à but non-lucratif et des syndicats. Et je suis d’accord, les livres sont de puissants outils, parce que ce sont aussi des archives ; ils peuvent circuler et inspirer d’autres initiatives.
Nos livres sont un processus collectif et transformateur, qui ont aussi leur place ailleurs que dans les librairies. C’est pourquoi nous nous rendons dans des écoles et participons à des manifestations. Nos pratiques au sein de la maison d’édition sont très intersectionnelles ; nous avons des liens avec les milieux militants, la communauté LGBTQ+, le mouvement antiraciste et la scène artistique. Cela permet de rassembler beaucoup de gens qui ne se parlent pas toujours en temps normal.
TW : Je voudrais juste intervenir parce que je pense que les différences culturelles sont intéressantes. Pendant deux, trois ans peut-être, il y a eu un rejet total des intellectuels, du milieu universitaire, de l’éducation. Je pense que c’était le début de la campagne de Trump, et c’était vraiment extrême, les gens étaient fiers d’être anti-éducation. Mon initiative est très différente, parce qu’il s’agit d’aider les gens à comprendre pourquoi il est important d’avoir une approche critique de tous les sujets. Nous voulons donner le droit d’analyser et de remettre en question le monde, de réfléchir, et même de réimaginer ce monde.
La plupart d’entre nous ne font que suivre une routine : travailler, rentrer à la maison, regarder la télé, et refaire la même chose le lendemain. Nous pouvons accumuler des biens matériels au fil du temps, mais cela ne signifie pas nécessairement que nous participons activement à des activités culturelles ou déterminantes pour l’avenir. Je ne porte aucun jugement, mais c’est une observation qui me pousse à intervenir et souligner le fait que nous avons toujours le choix : soit nous acceptons le monde tel qu’il est, soit nous essayons de le changer. Le fait est que l’architecture, la nourriture, et les livres que nous découvrons sont tous nés de l’imagination de quelqu’un, mais nous avons nous aussi le pouvoir d’influer sur notre environnement. Malheureusement, beaucoup d’entre nous sont prisonniers de leur routine, à essayer de survivre, au lieu d’être engagés activement avec le monde qui nous entoure.
Lydia, vous allez bientôt commencer votre résidence à la Villa Albertine. Comment comptez-vous travailler ici sur l’idée d’agentivité et d’émancipation que Tiana vient de décrire ?
LA : Je m’intéresse particulièrement au concept de militantisme associatif, qui est perçu très différemment en France et aux États-Unis. En France, l’idée même de communauté est stigmatisée, ethniquement et socialement. Le concept français de communautarisme implique une forme d’isolement volontaire. La croyance dominante est que les liens communautaires forts sont un obstacle à l’intégration dans la société au sens large. Cette idée est accentuée par l’insistance de l’État français à ne pas tenir compte des origines ethniques et à considérer que l’égalité passe par une négation des différences. De ce point de vue, pour être vraiment Français, on doit renoncer à son identité culturelle et religieuse. Bien sûr, nous savons que le refus de tenir compte des origines ethniques et la notion d’intégration à tout prix sont un mythe, voire un mensonge délibéré. À l’inverse, aux États-Unis, le fait d’appartenir à une communauté est généralement considéré comme quelque chose de positif et d’enrichissant.
Ma résidence se concentrera principalement sur la façon dont le militantisme associatif appréhende les livres. Je sais qu’il existe une culture des clubs de lecture très vivace aux États-Unis et une réelle capacité à les rendre ludiques. Je compte participer à des clubs de ce type et me rendre dans des bibliothèques indépendantes. À Los Angeles, j’aimerais beaucoup visiter la Radical Hood Library, créée par la rappeuse Noname. J’espère que ce séjour me donnera de nombreuses idées pour enrichir mes pratiques.
TW : Je te conseille aussi d’aller en banlieue ; c’est là que je recueille les données qui m’ont permis de comprendre que même les personnes qui ont des diplômes et des emplois bien payés se contentent parfois de survivre en suivant une routine.
Vous mentionnez les banlieues. Arrêtons-nous un moment sur ce terme, qui a une connotation différente en France et aux États-Unis. En France, les banlieues sont souvent synonymes de comme des zones de déclassement social. Lydia, pourriez-vous nous en dire davantage, et faire le lien avec vos remarques sur l’architecture postcoloniale ?
LA : Quand je pense aux banlieues américaines, j’imagine souvent un décor à la Desperate Housewives. Les banlieues françaises, à l’inverse, sont victimes d’une importante stigmatisation sociale et ethnique. Ces zones sont majoritairement habitées par les descendants de populations issues des anciennes colonies françaises et souffrent d’un manque notable d’infrastructures. Habitant Marseille, la deuxième plus grande ville de France, j’ai pu constater par moi-même un certain nombre de problèmes. Entre autres, le manque de liens entre les différents quartiers, la ségrégation sociale et ethnique, et la politique des transports publics, avec par exemple des bus qui ne desservent que certaines zones, ce qui empêche les résidents des Quartiers Nord d’accéder aux plages. Bien que de nombreuses associations à but non lucratif se soient engagées activement dans l’action sociale, il semble que l’État préfère se décharger de ses responsabilités sur ces organisations, qui manquent de financements, plutôt que de s’attaquer de front à ces problèmes.
TW : C’est fascinant, ces différences. Ce qui me parle, c’est la façon dont l’architecture et l’urbanisme ont contribué historiquement à la ségrégation et à la marginalisation. Dans notre région, par exemple, le réseau de bus est intentionnellement conçu pour empêcher certaines communautés d’entrer en contact, ce qui reflète une stratégie destinée à maintenir la ségrégation. Je m’intéresse tout particulièrement au contexte historique dans lequel ces décisions ont été prises. Aux États-Unis, par exemple, les lois spécifiques mises en place pendant l’ère Jim Crow étaient fondées sur l’idée que la proximité physique conduit à l’intégration sociale et culturelle. Pour éviter cela, des mesures ont été prises pour assurer la séparation des communautés.
En étudiant une zone densément peuplée comme Jersey City dans le cadre de la Nuit des Idées, nous sommes témoins d’importants changements et confrontés à une pression immense. On peut établir un parallèle avec ce qui se passe au niveau mondial : l’augmentation du coût de la vie en ville conduit à une forme d’exode massif. Même des gens qui ont un emploi stable et qui avaient jusqu’ici les moyens de se loger risquent aujourd’hui de se retrouver sans toit. Cette situation reflète une crise plus globale.
Quels sont les défis essentiels à relever et les priorités que vous vous fixez aujourd’hui, concernant cette question de la sous-représentation, en tant que membres de communautés affranchies et post-colonialistes ?
TW : J’ai tendance à remettre en question cette façon de voir les choses. En tant que Caribéenne, j’ai reçu une éducation qui mettait l’accent sur l’émancipation, héritage des enseignements [du militant panafricaniste] Marcus Garvey, que suivaient mes parents et mes grands-parents. En grandissant dans le Queens, à New York, dans les années 1970 et 1980, la jeune Noire d’origine caribéenne que j’étais a bénéficié du multiculturalisme de l’une des villes les plus diverses de la planète, et je ne me suis jamais sentie inférieure à qui que ce soit. Je suis pleinement consciente des réalités de la sous-représentation, mais mon travail se concentre davantage sur les problématiques du pouvoir et de la liberté. Le langage que nous utilisons, les catégories dans lesquelles nous nous plaçons, affectent profondément notre vision du monde.
Je plaide pour une approche collective qui accepte les nuances et l’inconnu, ce que [l’écrivain et philosophe] Édouard Glissant appelait l’opacité. L’amour et la curiosité sont, je crois, essentielles pour s’attaquer aux problématiques auxquelles nous sommes tous confrontés : je ne crois pas qu’un groupe puisse être libre ou se libérer indépendamment des autres ; nous sommes tous connectés, que cela nous plaise ou non. Mon rôle est de faciliter les contacts et les conversations entre divers groupes qui n’interagiraient pas en temps normal.
L’un des aspects essentiels de mon travail est la remise en question de la notion selon laquelle les peuples caribéens se voient comme des marginaux. Accepter cette façon de présenter les choses – se voir comme sous-représenté, comme une minorité – peut constituer un désavantage pour les personnes concernées, que ce soit sur le plan mental, émotionnel, spirituel ou intellectuel. Je rejette ce cadre restrictif. Mon intérêt pour la philosophie vient d’un désir de comprendre comment nous nous percevons et quel langage nous utilisons pour exprimer ces perceptions.
Mon objectif est de favoriser le dialogue entre différentes communautés et expériences de vie, pour permettre aux individus de se voir les uns les autres avant tout comme des êtres humains.
Lydia, voulez-vous réagir à ce que vient de dire Tiana ?
LA : En France, l’état d’esprit dominant est celui du refus de tenir compte des origines ethniques, comme je l’évoquais tout à l’heure. Cette philosophie est notamment évidente dans notre système scolaire, où certains enseignants, inspirés par les travaux [du pédagogue brésilien] Paolo Freire et de [la militante afro-américaine] bell hooks, s’efforcent de renforcer l’inclusivité et la diversité dans leurs classes. Leur objectif est de représenter des individus de différents milieux et origines dans différents domaines et rôles, encourageant ainsi les élèves à développer une imagination libre et diverse. On peut prendre comme exemple les cours sur l’Antiquité égyptienne. En général, les manuels scolaires n’évoquent que des archéologues britanniques caucasiens, et laissent dans l’ombre leurs confrères égyptiens. Ces enseignants recherchent activement d’autres ressources pour pallier ce déséquilibre. Cependant, je crois que la question de la représentation dépasse la simple notion de visibilité. Il est impératif d’étudier plus en profondeur les structures qui sous-tendent ces représentations, en particulier la division ethnique du travail, au lieu de se contenter de mettre sporadiquement en avant des artistes non-caucasiens. Il ne s’agit donc pas seulement de représentation, mais d’un problème systémique auquel il convient de prêter une attention particulière.
TW : J’adore cette nuance culturelle. Tu as évoqué le refus de tenir compte des origines ethniques, et je comprends les implications et l’impact de ce concept en France. Cependant, je crois qu’aux États-Unis, notre mythe fondateur, c’est la méritocratie. Nous nous accrochons désespérément à la croyance selon laquelle tout le monde peut réussir. Même si nous admettons que ce n’est pas totalement vrai, cette idée reste profondément enracinée dans l’esprit des Américains. Nous souffrons des rapports inégalitaires entre les ethnies dans notre société, mais il n’y a pas d’adhésion massive au refus de tenir compte des origines ethniques ou au principe d’intégration. Dans le climat économique actuel, on se concentre davantage sur la lutte pour survivre face à l’IA, le dérèglement climatique, et la détérioration des infrastructures du gouvernement plutôt que sur le combat en faveur du rapprochement entre les communautés.
Tiana Webb Evans est la fondatrice d’ESP Group LLC, un cabinet de conseil en stratégie de marque et en communication qui soutient des clients internationaux dans les secteurs de l’art, du design et de l’hôtellerie. Elle est également la fondatrice et la directrice créative de Yard Concept, une plateforme culturelle composée d’un journal numérique, d’une galerie et d’événements sous la forme de cercles de lecture qu’elle a créés et qui visent à favoriser la prise de conscience par le biais de l’art, du design et de la communauté. Plus récemment, elle a fondé la Jamaica Art Society, une initiative destinée à soutenir les professionnels de l’art jamaïcain et à célébrer son héritage en matière d’arts visuels. Outre ses activités professionnelles, Tiana écrit sur la culture, conseille et soutient les artistes émergents et partage son expertise en siégeant aux conseils d’administration du Project for Empty Space, du Female Design Council et de l’Atlanta Art Week. Elle fait également partie des comités consultatifs du Laundromat Project, des foires photographiques et de l’Art at a Time Like This.
Lydia Amarouche, éditrice et commissaire d’exposition basée à Marseille, est diplômée de l’École normale supérieure en sociologie, anthropologie et histoire. Elle explore divers documents d’archives pour créer des enquêtes éditoriales qui sont soit exposées, soit performées. En 2019, elle lance Corpus, une série de lectures collectives en libre accès qui traitent de l’histoire coloniale, des questions queer et féministes, du système pénitentiaire, de l’éducation et de l’art. En 2020, elle fonde Shed publishing, une plateforme d’édition et d’art qui publie des essais sur la théorie sociale et politique, et la littérature jeunesse. Lydia est également chargée de cours à l’université d’Aix-Marseille. En 2024, elle sera résidente de la Villa Albertine et se lancera dans un projet de recherche sur les pratiques de résistance dans l’édition et la littérature, en se concentrant spécifiquement sur les initiatives qui exploitent les livres comme un médium et un outil d’éducation politique et populaire.
